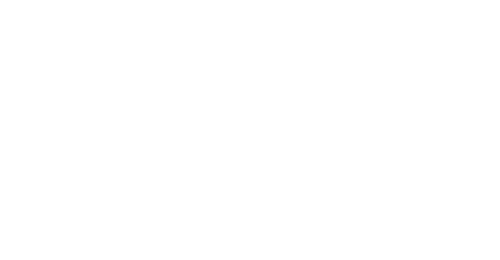-
Partager cette page
Éthique - Philosophie - Esthétique
17250015 - Philosophie des sciences
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Volume horaire total | 24 |
| Volume horaire CM | 24 |
Responsables
Objectifs
Montrer que les sciences peuvent faire place en leur sein à de la confiance, à des valeurs, à de l’incertitude, au pluralisme et à la controverse sans pour autant perdre leur rationalité et leur objectivité. Le cours s’appuiera de manière privilégiée mais non exclusive sur les débats dans les sciences biomédicales et les sciences de l’environnement.
Contenu
Master 1 - Semestre 2 - Année universitaire 2025-2026
Cours commun Master 1 mention Philosophie et Master 1 mention Histoire de la philosophie
Enseignante : Élodie GIROUX
Thème du cours : Les sciences en débat : preuve, objectivité, confiance
Argumentaire :
Les nombreuses controverses épistémologiques dans les sciences biomédicales, notamment à l'occasion de la pandémie de Covid-19, mais aussi dans les sciences environnementales autour par exemple du réchauffement climatique rendent plus urgente la réflexion sur la science, sa nature, ses valeurs, ses pouvoirs et ses buts. Elles révèlent un paradoxe du rapport que nous entretenons avec elle : à la fois de forts besoins et attentes (une autorité épistémique, un fondement pour la décision politique) et, en même temps, une fragilité (controverses, incertitudes, dimensions sociales et subjectives et poids des valeurs, etc.). Plus généralement, le rôle du scientifique dans la décision politique et la place des valeurs et de l’incertitude dans la connaissance scientifique sont réinterrogés. Faut-il considérer que les sciences ne peuvent pas donner ce qu’on attend d’elles, que la vérité scientifique est sociale et donc relative ?
L’enjeu dépasse le débat classique entre relativisme et rationalisme, constructivisme et positivisme. Il touche à la confiance que nous accordons aux scientifiques, à la communication et à la démocratie. Il est aussi avant tout celui d’une meilleure compréhension de ce qu’est effectivement la démarche scientifique. Il importe en outre de se doter de moyens de repérer le doute fécond de celui qui est fabriqué, opportuniste et contreproductif, et ainsi pouvoir discerner entre science et pseudo-science.
Pour lever un certain nombre de malentendus sur les sciences souvent considérées comme certaines, objectives et factuelles, nous commencerons par clarifier ce qu’est un fait scientifique, ce que peuvent les modèles, ce qu’est une preuve, et la place et le rôle des controverses. Puis, nous repenserons à partir de là : l’objectivité scientifique comme compatible avec les valeurs, la relation entre savoirs et politique, mais aussi le doute légitime et nous explorerons ainsi ce qui pourrait permettre de démarquer science et pseudo-science.
Public :
Ce cours s’adresse aux étudiants des deux masters philosophie et histoire de la philosophie et aux étudiants qui préparent les concours du CAPES ou de l’AGRÉGATION. Pour chacune des grandes thématiques de la philosophie générale des sciences abordées, un rappel sur leur traitement classique sera effectué avant de recourir à de nouveaux éclairages, notamment issus de développements récents de la philosophie sociale des sciences.
Cours commun Master 1 mention Philosophie et Master 1 mention Histoire de la philosophie
Enseignante : Élodie GIROUX
Thème du cours : Les sciences en débat : preuve, objectivité, confiance
Argumentaire :
Les nombreuses controverses épistémologiques dans les sciences biomédicales, notamment à l'occasion de la pandémie de Covid-19, mais aussi dans les sciences environnementales autour par exemple du réchauffement climatique rendent plus urgente la réflexion sur la science, sa nature, ses valeurs, ses pouvoirs et ses buts. Elles révèlent un paradoxe du rapport que nous entretenons avec elle : à la fois de forts besoins et attentes (une autorité épistémique, un fondement pour la décision politique) et, en même temps, une fragilité (controverses, incertitudes, dimensions sociales et subjectives et poids des valeurs, etc.). Plus généralement, le rôle du scientifique dans la décision politique et la place des valeurs et de l’incertitude dans la connaissance scientifique sont réinterrogés. Faut-il considérer que les sciences ne peuvent pas donner ce qu’on attend d’elles, que la vérité scientifique est sociale et donc relative ?
L’enjeu dépasse le débat classique entre relativisme et rationalisme, constructivisme et positivisme. Il touche à la confiance que nous accordons aux scientifiques, à la communication et à la démocratie. Il est aussi avant tout celui d’une meilleure compréhension de ce qu’est effectivement la démarche scientifique. Il importe en outre de se doter de moyens de repérer le doute fécond de celui qui est fabriqué, opportuniste et contreproductif, et ainsi pouvoir discerner entre science et pseudo-science.
Pour lever un certain nombre de malentendus sur les sciences souvent considérées comme certaines, objectives et factuelles, nous commencerons par clarifier ce qu’est un fait scientifique, ce que peuvent les modèles, ce qu’est une preuve, et la place et le rôle des controverses. Puis, nous repenserons à partir de là : l’objectivité scientifique comme compatible avec les valeurs, la relation entre savoirs et politique, mais aussi le doute légitime et nous explorerons ainsi ce qui pourrait permettre de démarquer science et pseudo-science.
Public :
Ce cours s’adresse aux étudiants des deux masters philosophie et histoire de la philosophie et aux étudiants qui préparent les concours du CAPES ou de l’AGRÉGATION. Pour chacune des grandes thématiques de la philosophie générale des sciences abordées, un rappel sur leur traitement classique sera effectué avant de recourir à de nouveaux éclairages, notamment issus de développements récents de la philosophie sociale des sciences.
Bibliographie
Bibliographie générale indicative :
Philosophie des sciences : manuels généraux, mise à niveau
Ouvrages sur le thème du cours
Philosophie des sciences : manuels généraux, mise à niveau
- Barberousse A., Kistler M., Ludwig P., La philosophie des sciences au XXe siècle, Champs Université, Flammarion, 2000.
- Barberousse A., Bonnay D. et Cozick M. (dir.), Précis de philosophie des sciences, Paris, Vuibert, 2011.
- Anjum R.L. and Rocca E., Philosophy of science, Palgrave Philosophy Today Series, 2024.
- Okasha, S., Philosophy of science: A very short introduction. Oxford University Press, 2002.
- Wagner P. (dir.) Logique et épistémologie, Vrin, 2025
Ouvrages sur le thème du cours
- Bensaude-Vincent B. et Dorthe G., Les sciences dans la mêlée, pour une culture de la défiance, Paris, Seuil, 2023.
- Claveau F. Prud’homme J., Experts, science et société, Presses Universitaires de Montréal, 2018.
- Dedieu F., Pesticides. Le confort de l’ignorance, Seuil, Anthropocène, 2022
- Douglas H., Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.
- Elliott K.C., A Tapestry of Values, An introduction to values in science, Oxford University Press, 2017.
- Fleck L. Genèse et développement d’un fait scientifique, Paris : Les Belles Lettres, (1935/2005).
- Girel M., Science et territoires de l’ignorance, Paris, Quae, Coll. "Sciences en questions", 2017.
- Goldenberg M., Vaccine Hesitancy: Public Trust, Expertise, and the War on Science, University of Pittsburgh Press, 2021.
- Kitcher P., Science, vérité et démocratie, Paris, P.U.F., 2010.
- Longino H., Science as social knowledge: Values and objectivity in scientific inquiry, 1990.
- Oreskes N. et Conwey E.. Les Marchands de doute ou Comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique, Paris, Ed. Le Pommier, (2010/2012).
- Pielke R.A., The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics. Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Proctor R., Golden Holocaust, La Conspiration des industriels du tabac, Paris (2011/2014).
- Solomon M., Making Medical Knowledge, Oxford University Press, 2015 (disponible en numérique via Diderot).
- Solomon M., Social Empiricism, The MIT Press, Cambridge Mass, 2001.
Contrôles des connaissances
Modalités d'évaluation : contrôle continu :
Deux travaux : oral et écrit :
Crédits ECTS :
Master 1 Histoire de la philosophie : 3
Master 1 Philosophie : 4
Deux travaux : oral et écrit :
- Un oral : exposé de 10 mn préparé seul ou à plusieurs qui développe une analyse appliquée d’une question abordée dans un des chapitres et selon le calendrier correspondant (plan et calendrier précis seront distribués le jour de la rentrée). Cette analyse appliquée concernera de préférence un sujet choisi en sciences de la santé ou de l’environnement mais pas nécessairement.
- Un écrit sur table de 30 mn à la fin du semestre, le 24 mars 2026 sur une problématique du cours.
Crédits ECTS :
Master 1 Histoire de la philosophie : 3
Master 1 Philosophie : 4
Formations dont fait partie ce cours
Renseignements pratiques
Faculté de Philosophie
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Mise à jour : 11 décembre 2025