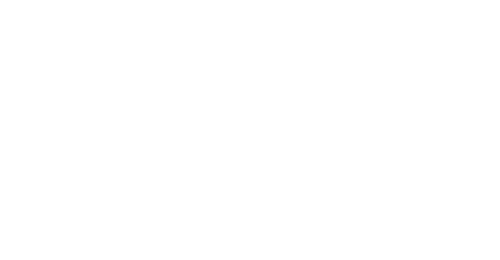AccueilFormation
-
Partager cette page
Éthique - Philosophie - Esthétique, Droit
17240072 - Éthique et droit
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Crédits ECTS | 4 |
| Volume horaire total | 24 |
| Volume horaire CM | 24 |
Responsables
Contenu
Master 2 - Semestre 4 - Année universitaire 2025-26
Enseignante : Johanna LENNE-CORNUEZ
Titre du cours : Féminisme(s) et droit
Programme du cours :
À partir d’une enquête sur les rapports entre féminisme et droit, le cours cherchera à définir les différents courants du féminisme du point de vue de leur critique du droit et de leurs attentes à son égard, mais aussi en retour à discerner la portée et les limites des réponses juridiques aux injustices faites aux femmes.
Dans une première partie, nous reviendrons sur les critiques féministes des théories du contrat social, et sur l’inégalité genrée des droits, constitutive de la modernité. Dans un deuxième temps, on s’interrogera sur la neutralité sexuelle du sujet de droit, en confrontant le modèle assimilationniste et le modèle différentialiste, mais aussi en discernant les types d’injustices faites aux femmes, inhérentes aux systèmes judiciaires. Dans un troisième temps, nous analyserons la façon dont les féminismes intersectionnel et postcolonial bousculent aussi bien la conception libérale des droits humains que le féminisme de la deuxième vague. Enfin, on s’intéressera aux stratégies féministes abolitionnistes anticarcérales qui choisissent de se détourner du droit pénal.
Le cours alternera entre l’analyse de perspectives féministes générales sur le droit et la traduction juridique de questions féministes déterminées (le droit à l’avortement ou la criminalisation du viol par exemple).
Enseignante : Johanna LENNE-CORNUEZ
Titre du cours : Féminisme(s) et droit
Programme du cours :
À partir d’une enquête sur les rapports entre féminisme et droit, le cours cherchera à définir les différents courants du féminisme du point de vue de leur critique du droit et de leurs attentes à son égard, mais aussi en retour à discerner la portée et les limites des réponses juridiques aux injustices faites aux femmes.
Dans une première partie, nous reviendrons sur les critiques féministes des théories du contrat social, et sur l’inégalité genrée des droits, constitutive de la modernité. Dans un deuxième temps, on s’interrogera sur la neutralité sexuelle du sujet de droit, en confrontant le modèle assimilationniste et le modèle différentialiste, mais aussi en discernant les types d’injustices faites aux femmes, inhérentes aux systèmes judiciaires. Dans un troisième temps, nous analyserons la façon dont les féminismes intersectionnel et postcolonial bousculent aussi bien la conception libérale des droits humains que le féminisme de la deuxième vague. Enfin, on s’intéressera aux stratégies féministes abolitionnistes anticarcérales qui choisissent de se détourner du droit pénal.
Le cours alternera entre l’analyse de perspectives féministes générales sur le droit et la traduction juridique de questions féministes déterminées (le droit à l’avortement ou la criminalisation du viol par exemple).
Bibliographie
Bibliographie préliminaire :
- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791)
- Sandra Harding, « Repenser l’épistémologie du positionnement : qu’est-ce que ‘l’objectivité forte’ ? » (1993) in Philosophie féministe. Patriarcat, savoirs, justice (M. Garcia éd.).
- Catharine A. MacKinnon, Le Féminisme irréductible. Discours sur la vie et la loi (1987)
- Susan Moller Okin, Justice, Genre et Famille (1989)
- Carole Pateman, Le Contrat sexuel (1988)
Contrôles des connaissances
Contrôle continu (CC)
Formations dont fait partie ce cours
Renseignements pratiques
Faculté de Philosophie
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Mise à jour : 22 septembre 2025