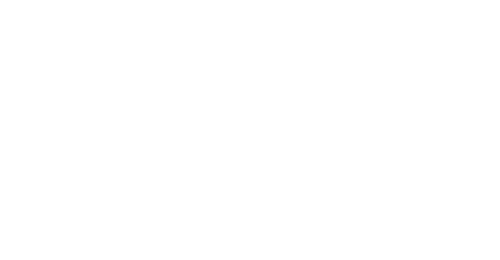-
Partager cette page
Droit - Science Politique, Éthique - Philosophie - Esthétique
17300017 - Philosophie du droit pénal
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Crédits ECTS | 4 |
| Volume horaire total | 18 |
| Volume horaire CM | 18 |
Responsables
Contenu
Licence 2 Philosophie (double cursus) et Double Licence 2 Droit - Philosophie - Semestre 4 - Année universitaire 2025-26
Enseignant : Nicolas NAYFELD
Thème du cours : Pourquoi punir ?
Présentation du cours :
Dans ce cours, nous nous intéresserons à la question la plus débattue en philosophie du droit pénal : Pourquoi punir ? Quelle est la raison d’être de l’institution pénale ? En a-t-elle une ? Après une clarification du problème et de la notion de punition, nous examinerons de façon critique l’opposition canonique entre l’approche utilitariste et rétributiviste de la peine, nous présenterons certaines tentatives de dépasser cette opposition, avant d’aborder quelques questions plus appliquées telles que la peine de mort ou la clémence du juge répressif.
Enseignant : Nicolas NAYFELD
Thème du cours : Pourquoi punir ?
Présentation du cours :
Dans ce cours, nous nous intéresserons à la question la plus débattue en philosophie du droit pénal : Pourquoi punir ? Quelle est la raison d’être de l’institution pénale ? En a-t-elle une ? Après une clarification du problème et de la notion de punition, nous examinerons de façon critique l’opposition canonique entre l’approche utilitariste et rétributiviste de la peine, nous présenterons certaines tentatives de dépasser cette opposition, avant d’aborder quelques questions plus appliquées telles que la peine de mort ou la clémence du juge répressif.
Bibliographie
En guise d’introduction, il est possible de consulter l’ouvrage de Bertrand Guillarme, Penser la peine, Paris, Puf, 2003, consultable en ligne sur Cairn : https://droit.cairn.info/penser-la-peine--9782130534990?lang=fr
Contrôles des connaissances
Contrôle Continu (CC)
Crédits ECTS 2025-26 : 4
Crédits ECTS 2025-26 : 4
Formations dont fait partie ce cours
Renseignements pratiques
Faculté de Philosophie
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Mise à jour : 22 septembre 2025