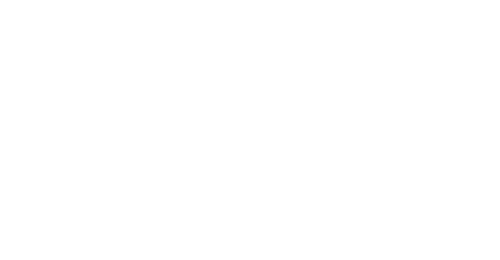-
Partager cette page
Éthique - Philosophie - Esthétique
17240007 - Philosophie politique
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Volume horaire total | 33 |
| Volume horaire CM | 18 |
| Volume horaire TD | 15 |
Responsables
- CHAMPANHET Lucas
Contenu
Licence 1 - Semestre 2 - MAJEURE Philosophie - UE Fondamentale - Année universitaire 2025-26
Enseignante : Lucas CHAMPANHET
Titre du cours : Le républicanisme et l’idée de République
Programme du cours :
Ce cours proposera un parcours historique depuis la Grèce antique jusqu’aux sociétés occidentales contemporaines autour du concept politique de république, comprise comme un régime politique opposé à la monarchie et visant le bien commun, et le républicanisme compris comme une idéologie politique mettant en avant la centralité des vertus civiques et donc de la participation politique dans le bon développement de l’individu et de la société.
De la politeia grecque chez Aristote à la Révolution française et aux soubresauts révolutionnaires du XIXe siècle qui donnent naissance à l’idée d’une République démocratique et sociale, en passant par le néo-républicanisme contemporain se revendiquant tout à la fois de Machiavel et Hobbes, ce cours est pensé comme une introduction à la philosophie politique et aux grandes questions qui traversent son histoire jusqu’à la situation contemporaine, à savoir : la question de la nature et de l’extension de la liberté, et de sa conciliation possible ou impossible avec des idéaux égalitaires ; la question du meilleur régime politique ; la question de la priorité entre l’individu et la société ; l’opposition moderne entre le libéralisme et le socialisme, lesquels peuvent tous les deux se revendiquer d’héritages républicanistes plus ou moins contradictoires.
Dans le prolongement du CM, les TD proposeront une lecture suivie du livre I du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau (à se procurer pour le cours dans l’édition GF).
Enseignante : Lucas CHAMPANHET
Titre du cours : Le républicanisme et l’idée de République
Programme du cours :
Ce cours proposera un parcours historique depuis la Grèce antique jusqu’aux sociétés occidentales contemporaines autour du concept politique de république, comprise comme un régime politique opposé à la monarchie et visant le bien commun, et le républicanisme compris comme une idéologie politique mettant en avant la centralité des vertus civiques et donc de la participation politique dans le bon développement de l’individu et de la société.
De la politeia grecque chez Aristote à la Révolution française et aux soubresauts révolutionnaires du XIXe siècle qui donnent naissance à l’idée d’une République démocratique et sociale, en passant par le néo-républicanisme contemporain se revendiquant tout à la fois de Machiavel et Hobbes, ce cours est pensé comme une introduction à la philosophie politique et aux grandes questions qui traversent son histoire jusqu’à la situation contemporaine, à savoir : la question de la nature et de l’extension de la liberté, et de sa conciliation possible ou impossible avec des idéaux égalitaires ; la question du meilleur régime politique ; la question de la priorité entre l’individu et la société ; l’opposition moderne entre le libéralisme et le socialisme, lesquels peuvent tous les deux se revendiquer d’héritages républicanistes plus ou moins contradictoires.
Dans le prolongement du CM, les TD proposeront une lecture suivie du livre I du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau (à se procurer pour le cours dans l’édition GF).
Bibliographie
Bibliographie :
► Un corpus complet des textes étudiés sera partagé avant le début des cours.
- Nicolas Machiavel, Discours sur la Première Décade de Tite-Live [1513-1519], Belles Lettres, 2022.
- Thomas Hobbes, Léviathan [1651], Folio.
- *Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social [1762], GF. [À se procurer en priorité.]
- Karl Marx & Friedrich Engels, Sur la Commune de Paris : Textes et controverses, Éditions Sociales, 2021.
► Un corpus complet des textes étudiés sera partagé avant le début des cours.
Contrôles des connaissances
CM : Terminal écrit (TE) 4h
TD : Contrôle continu (CC)
Crédits ECTS :
TD : Contrôle continu (CC)
Crédits ECTS :
- Licence Philosophie : 4 (CM : 2 ; TD : 2)
- Licence Droit-Philosophie : 6 (CM : 3 ; TD : 3)
Formations dont fait partie ce cours
Renseignements pratiques
Faculté de Philosophie
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Adresse postale :
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Sur Internet
Mise à jour : 22 septembre 2025